Le temps se dilate : Einstein ou Dali ?
- Élanore

- 28 juin 2018
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 août 2019

Il arrive souvent de trouver que le temps passe plus vite, ou alors qu’il s’allonge (en particulier dans la salle d’attente de votre médecin débordé). Pourtant, les aiguilles de votre montre (ou celles de l’horloge sur le mur de la salle d’attente) tournent toujours à la même vitesse, ce qui veut dire que le temps s’écoule de façon identique. Cependant, il arrive parfois que le temps n’avance pas à la même vitesse partout, qu’il se « dilate », à la mode Dali. C’est ce qu’on appelle le phénomène de dilatation des durées. Il a été expliqué par la théorie de la relativité restreinte, présentée par Albert Einstein en 1905. Pour comprendre la dilatation des durées et la théorie de la relativité restreinte, il est nécessaire de se familiariser avec quelques notions importantes.
Le mot qui va revenir très souvent dans cet article est le référentiel. C’est un élément clef pour la compréhension de tout ce qui va suivre, il est donc primordial d’en connaitre la définition. Un référentiel (en physique) est un repère qui nous sert à définir et à situer un évènement dans l’espace et le temps. Ce qui veut dire que si nous décrivons un évènement dans un référentiel A, il sera vu différemment dans un référentiel B. Un exemple très simple qui permet d’illustrer le référentiel est celui d’un train en mouvement. Un ami vous accompagne à la gare pour votre départ en vacances. Vous montez dans le train, et votre ami vous observe sur le quai, histoire de s’assurer que vous trouviez bien votre place. Ça y est, votre valise est rangée et vous voilà assis à votre place, faisant signe à votre ami que tout va bien. Le train démarre et avance doucement. Votre ami resté sur le quai vous voit partir dans la même direction que le train : pour lui, vous êtes en mouvement. Mais vous, vous êtes bien assis dans le train et vous ne bougez pas ! Dans le référentiel de votre ami, vous avancez, mais dans le référentiel du train, vous êtes immobile. Autrement dit : par rapport à votre ami, vous bougez, alors que par rapport au train vous ne bougez pas. C’est le même évènement décrit dans deux référentiel différent. Bien, maintenant que la notion de référentiel est acquise, continuons.
Dans cette explication, il sera indispensable d’utiliser un outil pour mesurer le temps. Cet outil s’appelle une horloge. Elle sera accrochée à un référentiel et y mesurera des intervalles de temps. Attention, chaque horloge est assignée à un référentiel et elle n’en change jamais ! Ces horloges seront capable de mesurer des durées très courtes ou très longues. Nous supposons qu’elles fonctionnent à la perfection, qu’elles n’ont pas de masse et qu’elles n’auront aucune influence sur les évènements. Ce sont des horloges « parfaites ». Ces horloges vont pouvoir mesurer des durées, que nous allons utiliser pour calculer des vitesses. La vitesse se calcule grâce à la formule v = d/t, où d est la distance parcourue pendant la durée t. C’est grâce cette formule que vous allez comprendre le phénomène de dilatation des durées. En effet, cette formule peut s’écrire t = d/v ou bien d = v x t et nous permet donc de connaître une donnée en fonction des deux autres. Lorsqu’il s’agit de la lumière, la vitesse est notée c (pour « célérité ») et sa valeur est connue. Vous disposez maintenant de toutes les notions nécessaires à la compréhension de ce qui va suivre (n’hésitez pas à les relire pour vous assurez de bien tout comprendre). Passons aux choses sérieuses : la théorie de la relativité restreinte.

La théorie de la relativité restreinte est à différencier de celle de la relativité générale, qui sont pourtant toutes deux présentées par Albert Einstein. La théorie de la relativité générale, publiée en 1915, n’est en fait qu’une généralisation de la relativité restreinte, parue en 1905. Cette dernière comporte un énoncé qui va nous être très utile : la vitesse de la lumière dans le vide, c, est constante. Peu importe le référentiel et la vitesse de celui-ci, la vitesse de la lumière aura toujours la même valeur : c ≈ 300 000 km/s. Ce qui veut dire qu’en une seconde, la lumière parcourt environ 300 000 kilomètres, systématiquement. C’est dans la théorie de la relativité restreinte que nous pouvons trouver la très célèbre formule E = mc² (qui montre le lien entre la matière et l’énergie), et l’énoncé qui dit que l’espace et le temps sont liés, dotant ainsi l’univers d’une quatrième dimension : le temps. La théorie de la relativité générale, quant à elle, va donner une nouvelle vision de la gravitation. C’est dans cette théorie que nous trouvons l’idée d’un espace-temps élastique qui se courbe sous la masse des objets (exemple : une planète), créant des pentes sur lesquelles d’autres objets vont glisser*. Mais en quoi tout cela va-t-il nous aider à comprendre le phénomène de dilatation des durées ? Nous entrons dans le vif du sujet.
La relativité restreinte nous dit que la vitesse de la lumière est toujours la même, peu importe le référentiel. C’est ce que nous allons utiliser pour comprendre comment le temps se dilate. Imaginons une petite expérience afin de bien visualiser la chose. Prenez deux miroirs, que vous positionnez face à face, à quatre centimètres l’un de l’autre (voir schéma ci-dessous).

Sur le miroir du bas, il y a un laser. Ce dernier lance un rayon lumineux vers le haut. Le rayon parcourt donc deux fois quatre centimètres (rayons bleus) en un temps t = d/c (où d = 8 cm). Maintenant, imaginez que les deux miroirs avancent à la même vitesse de façon à ce qu’ils soient toujours face à face, comme s’ils étaient dans un train (voir schéma ci-dessous).

Le trajet du rayon lumineux sera différent et donc la distance parcourue pour faire un aller-retour ne sera pas la même ! Nous savons que la vitesse de la lumière ne change pas. Le temps de parcours du rayon lumineux est donc t' = d'/c (où d = 10cm). Comme d' est plus grande que d et que la vitesse de la lumière c ne varie pas, la durée du parcours t' est plus grande que la durée t ! Pour un observateur externe au système des miroirs (c’est-à-dire qui se trouve devant le dispositif et non à l’intérieur de celui-ci), le temps semble s’écouler plus lentement lorsque les miroirs sont en mouvement.
Ce phénomène n’est pas une illusion, mais il n’est significatif que pour des objets voyageant à au moins un dixième de la vitesse de la lumière, c’est-à-dire à au moins 30 000 km/s. Cela parait absolument impossible dans la vie courante de pouvoir observer ce phénomène, et pourtant nous y sommes confrontés très souvent, voir même tous les jours pour certains. En effet, le GPS de votre voiture est obligé de tenir compte de la dilatation des durées, sinon cela fausserait votre position de plusieurs dizaines de mètres (et vous ne voulez sûrement pas être perdu au beau milieu de nulle part avec un GPS qui ne sait plus où vous êtes). Votre GPS calcule votre position en envoyant un signal au satellite le plus proche, qui renvoie le signal comme un miroir. Ainsi votre GPS calcule le temps de parcourt de l’information et il en déduit votre position. Mais votre voiture, ainsi que le satellite en orbite, sont en mouvement, et la vitesse de l’information envoyée est celle de la lumière, donc le phénomène de dilatation des durées doit entrer en compte dans les calculs de votre GPS.

Une expérience de pensée a été présentée par Paul Langevin (ci-contre) en 1911. Cette expérience s’appelle aujourd’hui le paradoxe des jumeaux. Elle permet de voir la dilatation des durées sous un autre angle. Des jumeaux naissent sur Terre. Quelques années plus tard, l’un des deux part à bord d’une fusée pour un voyage dans l’espace. La fusée voyage à une vitesse proche de celle de la lumière et ne fait aucune escale (c’est un aller-retour dans l’espace). Il y a une horloge sur Terre et une autre dans la fusée. Le temps s’écoule exactement de la même façon sur les deux horloges. pourtant, selon le phénomène dilatation des durées de la relativité restreinte, la durée du voyage va sembler plus longue au jumeau qui est resté sur Terre. Par exemple, entre le départ de la fusée et son arrivée sur Terre, le jumeau resté sur Terre aura attendu une semaine. Pourtant, lorsque son frère descend de la fusée, il lui assure que son voyage n’a duré que six jours. Le temps s’est dilaté, et le jumeau parti en voyage a vu s’écouler moins de temps que son frère sur Terre : le jumeau voyageur est donc rentré plus jeune que son frère.

Le phénomène de dilatation des durées a été repris et adapté au cinéma, comme dans le film Interstellar par exemple, dans lequel le temps s’écoule différemment sur une planète et dans leur vaisseau. C’est un phénomène qui semble abstrait et complexe à première vue, mais en y regardant de plus près, cela devient plus proche de nous et de notre quotidien, sans avoir besoin de formules lourdes et quelque peu illisibles pour le commun des mortels. Pensez donc au temps qui se dilate la prochaine fois que vous suivrez votre GPS !
* Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’article « Ondes gravitationnelles et trous noirs binaires » dans lequel j’explique comment fonctionne cette gravitation
Images :
http://equerre.blogspot.com/2014/09/montre-molle-au-moment-de-la-premiere.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Langevin
http://www.univers-astronomie.fr/articles/physique-theorie/125-le-paradoxe-des-jumeaux.html
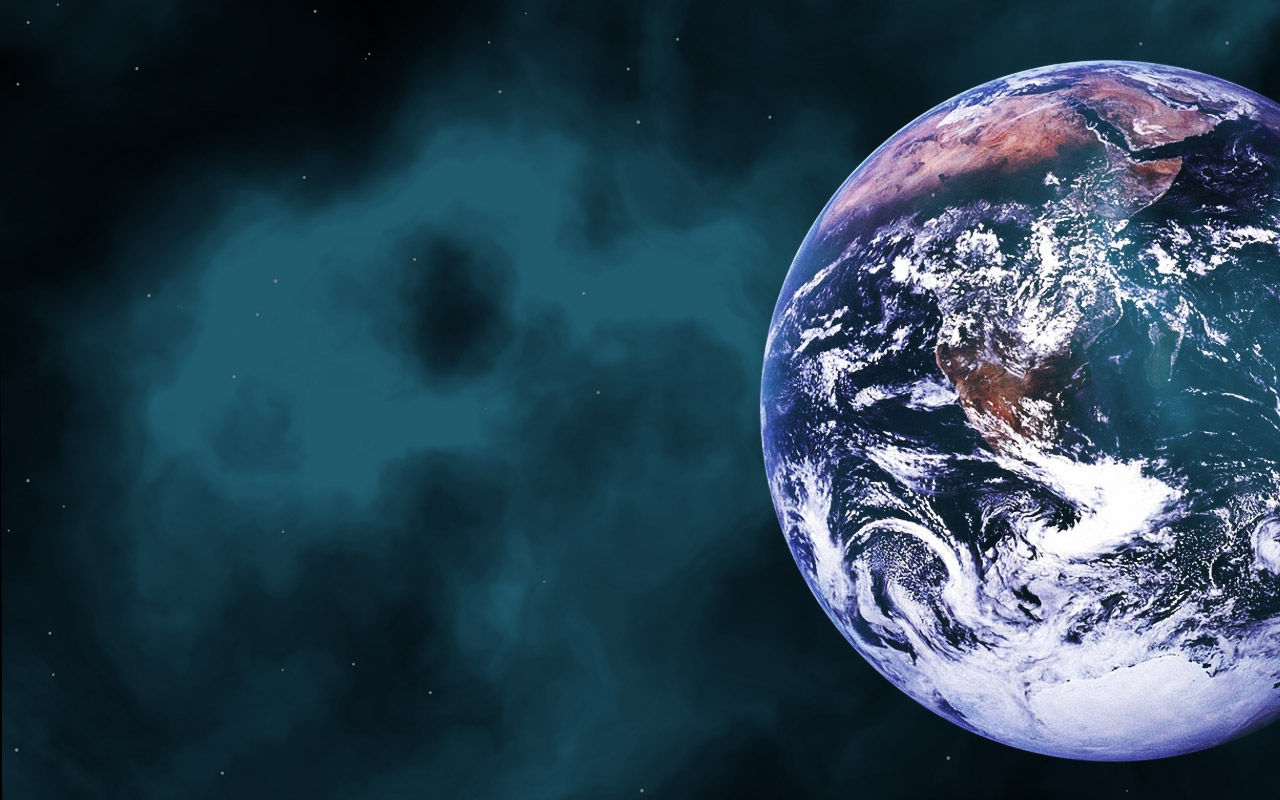


https://1drv.ms/f/s!AkcvZoHpfhMxgtdTk_-KmktSBHyqRQ